Histoire et condition de la classe ouvrière japonaise dans le second après-guerre
[top] [content] [next]
Fort d’une puissance économique sans cesse croissante, de succès commerciaux ininterrompus, le capitalisme japonais, d’ancien vaincu de la dernière guerre mondiale, est devenu un acteur de premier plan sur la scène mondiale. Confirmant la thèse marxiste qui veut que le capitalisme trouve dans les destructions un bain de jouvence qui lui permet de recommencer un cycle d’accumulation et d’expansion avec une ardeur juvénile, le capital nippon bat aujourd’hui en brèche dans plusieurs secteurs la suprématie du super-impérialisme américain. Pour les capitalistes occidentaux le « péril jaune » acquiert une nouvelle réalité, non sous la forme des hordes innombrables de population menaçant la domination blanche, comme dans les cauchemars bourgeois au siècle dernier, mais sous la forme d’un flot incessant de marchandises « made in Japan » qui inondent le marché mondial.
Les études succèdent aux études pour tenter de comprendre les secrets du « miracle japonais » et pour trouver des recettes applicables ici, des « cercles de qualité » au « salaire au mérite », etc. Tous les commentaires, qu’ils émanent de bourgeois envieux ou de bonzes syndicaux qui feignent de le critiquer, mettent en relief « l’harmonie sociale », la responsabilité et la discipline de la main d’œuvre qui n’hésite jamais à sacrifier ses intérêts « égoïstes » aux intérêts « communs » de l’entreprise et de l’économie nationale.
Ce qui nous intéresse, c’est d’essayer de comprendre les causes de la paralysie d’une classe ouvrière qui a pourtant donné dans le passé de magnifiques exemples de lutte, en dépit d’une répression féroce et constante : des grèves de 1906 et 1907 dans les Chantiers navals et les Mines, aux grèves nationales et aux vagues de manifestations lors des « émeutes du riz » contre la vie chère en 1918; des agitations dans les grandes industries en 1920–21, à leurs échos dans les campagnes parmi les travailleurs agricoles et les paysans pauvres, les prolétaires japonais avant la dernière guerre mondiale ont mené de durs combats, ce qui, en passant, démontre l’absurdité des bavardages sur les « traditions » de discipline et de consensus inhérentes à « l’âme » japonaise.
Un article de « Bilan », No. 8, organe de la fraction de gauche du PC italien, nous fournit quelques précisions :
« Le mouvement ouvrier au Japon remonte à 1897, dans la période d’essor qui suivit la victoire contre la Chine, quand Sen Katayama, devenu socialiste aux États-Unis, créa à Tokyo la Société pour la formation des syndicats (Rōdō Kumiai Kiseikai). Le premier syndicat de classe fut celui des métallurgistes [Tekkō Kumiai], dont Katayama devint le secrétaire. Peu après fut publié par cette société le premier journal socialiste, « Monde des travailleurs » [« Rōdō Sekai »]. Puis furent créés les syndicats des typos, machinistes et mécaniciens des chemins de fer, dont la grève en 1898 eût un grand retentissement. Entre 1897 et 1900, favorisé par l’absence de lois répressives, découlant du fait que ni le gouvernement, ni les patrons ne se rendaient compte de la portée du mouvement, se vérifia la transformation des guildes existantes en syndicats, travail auquel se mêlèrent beaucoup d’éléments de la petite-bourgeoisie démocratique et qui trouva même l’appui de certains industriels.
Mais en mars 1900, le parlement japonais vota un « règlement de police pour la défense de la paix publique » qui interdit en réalité toute action revendicative. Cette loi donna le coup de grâce au mouvement ouvrier à peine naissant. » (« Bilan », No 8, 1932).
Dès lors la répression ne cessa pas contre le mouvement ouvrier et socialiste. Nous n’allons pas traiter ici des difficultés extraordinaires de la création d’un Parti Communiste face à cette répression brutale et sanguinaire, et devant les énormes faiblesses politiques des militants d’un mouvement ouvrier sans aucune tradition marxiste, sans oublier la responsabilité de l’Internationale Communiste en dégénérescence qui imposait artificiellement ses « lignes » contradictoires. L’Internationale finit par assigner au prolétariat la tâche de faire la révolution bourgeoise antiféodale dans un Japon pourtant bourgeois et impérialiste…
Au cours des années 30 le mouvement ouvrier fût de plus en plus encadré sous l’égide de l’État. En 1925 la Sōdōmei (Confédération des syndicats) exclut les syndicats de gauche, qui constituèrent le Nihon Rōdō Kumiai Hyōgikai (Conseil japonais des syndicats), interdit en 1928. En 1937 la Sōdōmei renonce explicitement à la grève; en 1940 elle accepte de collaborer avec le gouvernement et fusionne avec les syndicats des ouvriers de l’État (extrême-droite) pour former une centrale unique, la Sampō (Association Industrielle Patriotique), parachevant ainsi l’œuvre de « militarisation » du prolétariat en vue de la guerre. Dans le même temps les années 40 sont marquées par la généralisation à l’industrie du système déjà expérimenté entre 1900 et 1910 pour favoriser la stabilité de la main d’œuvre, de « l’emploi à vie » .
En se combinant aux ravages du stalinisme contre-révolutionnaire, ces traits caractéristiques du « fascisme » nippon légués à la nouvelle « démocratie », devaient profondément influer sur les conditions de vie, de travail et de lutte des prolétaires japonais tout au long de ce second après-guerre.
Au moment de la défaite et de l’occupation américaine la classe ouvrière japonaise était presque complètement enchaînée au char de la collaboration avec l’État (même si les épisodes de « résistance passives », de l’absentéisme au sabotage, à la destruction des armes et à la désertion[1] n’ont pas manqué dans la période de guerre).
D’autre part en dépit de la défaite terrible ce ne fut pas une période d’anarchie politique semblable à ce qui eut lieu en Italie par exemple, car l’occupation américaine se substitua immédiatement à l’appareil d’État en débâcle pour remettre ensuite le pouvoir entre les mains de la grande bourgeoisie traditionnelle.
La « démocratisation » imposée par le SCAP (Supreme Commander of Allied Powers, soit le Commandement Suprême des Puissances Alliées) c’est-à-dire par MacArthur, a eu comme but précisément de prévenir et de contrôler toute explosion de colère prolétarienne.
Comme en Europe, les USA après avoir vaincu militairement le « fascisme » japonais gagnèrent leur bataille contre la classe ouvrière grâce à la « démocratie ». Comme en Europe cette tentative réussit pleinement grâce aux partis pseudo ouvriers « renaissants » : le Parti Socialiste Japonais (constitué le 2 novembre 1945) et le Parti Communiste Japonais (reconstitué le 4 décembre 1945 après la libération de nombreux dirigeants emprisonnés par l’ancien régime), dont le premier était clairement disposé à collaborer avec les américains, mais dont le deuxième, lié à l’URSS, ne leur était pas le moins du monde hostile.
« A l’époque, les américains favorisaient les modérés et les sociaux-démocrates et considéraient les communistes comme une force utile »[2].
Ce n’est pas un hasard si dans les premières années du SCAP s’est constitué le seul gouvernement « socialiste » de toute l’histoire japonaise (1947), ni si les américains se sont préoccupés rapidement du mouvement syndical. Tandis qu’ils concédaient le droit de grève et dissolvaient « l’Association Industrielle Patriotique » (Sampō) pour rétablir la « liberté » d’organisation syndicale, ils chercheront à régler cette délicate question en s’efforçant de modeler l’associationnisme ouvrier sur le modèle américain du syndicat d’entreprise continuant ainsi sur un plan plus élevé (c’est-à-dire démocratique à favoriser la collaboration dans l’entreprise avec la direction. La dissolution formelle de la Sampō ne contredit pas ce fait car ces « enterprise unions » comprenaient tous les travailleurs de l’entreprise à l’exception du directeur ou peut-être des cadres les plus élevés.
Toutefois, la syndicalisation battit tous les records après la guerre : alors que le niveau maximum d’inscrits au syndicat avant guerre s’établissait à 420 600 en 1936[3], il montait en 1946 à 4 500 000[4]. Et si le nombre était élevé, il est aussi indéniable qu’à plusieurs reprises la classe ouvrière donna des preuves de sa combativité.
Cependant, même s’il ne pouvait pas ne pas réagir d’une façon ou d’une autre aux conditions désespérées dans lesquelles l’avait précipité la défaite, il était impossible que le prolétariat nippon, privé depuis longtemps de guide et d’organisation de classe, et soumis alors à l’influence désastreuse des partis réformistes renaissants grâce à l’aimable attention de… MacArthur, puisse être en mesure de trouver un terrain de lutte indépendant et de classe.
Ce n’est pas un hasard si le type le plus caractéristique d’action ouvrière de l’époque était la tentative d’auto-gérer les nombreuses usines abandonnées par les capitalistes (qui attendaient que les conséquences de la fin des hostilités se dissipent et que la production puisse reprendre). Initiés par l’opportunisme et loués aujourd’hui par les historiens pseudo-marxistes de la New-Left comme John Halliday, ces épisodes de « contrôle ouvrier » ne furent en réalité que le sacrifice aveugle du prolétariat aux exigences de la reconstruction. Les grèves dans l’industrie furent en fait très rares et les heures perdues en agitation revendicatrice n’atteignirent qu’un pourcentage infime. C’étaient précisément les usines « auto-gérées » qui avaient les horaires de travail les plus élevés, la semaine de travail la plus longue, les rythmes les plus bestiaux (ce fut le cas par exemple de la Keisei Electric Railway Company [Keisei dentetsu kabushiki kaisha]). Ce fut même le personnel qui dût « convaincre » le patronat de reprendre en main la gestion de l’entreprise.
Entre temps, en 1946, le SCAP avait posé à sa manière la question de la « renaissance » des organisations syndicales semblables à celles qui apparaissaient ou qui étaient sur le point d’apparaître dans les autres pays vaincus; c’est-à-dire des organisations non seulement dociles aux exigences de la politiques et de l’économie bourgeoise, mais aussi suffisamment importantes et influentes pour constituer un antidote contre les tentations spontanées de résistance ouvrière. Ainsi, en août naquirent deux organisations distinctes, la Sōdōmei, ouvertement « jaune » et collaborationniste avec le vieux personnel de la Sampō, et la Sambetsu Kaigi, influencée par la gauche opportuniste et au fond guère moins collaborationniste. Il va de soi que leur naissance n’avait rien à voir avec une séparation entre syndicat classiste et syndicat non classiste, mais découlait de contradictions internes à l’appareil politique bourgeois liées à des influences internationales bien précises, d’autant que de février 1947 à juin 1948 une véritable collaboration officielle régna entre la Sambetsu et la Sōdōmei. Et le PCJ et le PSJ se situaient dans les faits nettement sur le terrain national en acceptant l’impératif de la reconstruction de l’État et de l’économie.
Toutefois, la Sambetsu regroupait indéniablement la fraction la plus combative du prolétariat. Il est intéressant de relever que la fraction la plus aguerrie de la Sambetsu était celle des travailleurs du secteur publique (comprenant les couches inférieures des cols blancs de l’État) et en particulier les prolétaires du transport public. La chose s’explique : d’une part le secteur publique avait été peu touché par le climat de collaboration intra-entreprise imposé par la Sampō. D’autre part, la structure même du secteur publique s’opposait d’une certaine façon après la reconquête des « libertés » syndicales à l’extension de cet « esprit d’entreprise » que le SCAP et les partis réformistes n’avaient pas cessé de favoriser.
Etant donné la faillite d’une politique syndicale unitaire et l’atmosphère qui régnait dans les services publiques, le SCAP se mit à s’occuper du problème syndical au moyen du Labor Relations Adjustement Law qui, en plus d’interdire les grèves et les syndicats dans la police, chez les gardiens de prison et chez les pompiers interdisait les grèves des employés du gouvernement et introduisait une procédure d’arbitrage dans les luttes des « travailleurs d’utilité publique » comprenant l’obligation d’un préavis d’au moins 30 jours pour les grèves.
La pression de la classe en général et des travailleurs des services publiques en particulier ne semblait cependant pas s’atténuer rapidement au point que la Sambetsu fut contrainte plus d’une fois à lancer des luttes mêmes importantes, comme la grève du premier février contre la politique économique du gouvernement qui fut d’ailleurs interdite le jour même par le SCAP, réduisant ainsi les très légalistes dirigeants syndicaux à une honteuse impuissance.
Comme il ne réussissait pas du tout à freiner le mécontentement prolétarien, le SCAP comprit que le temps était venu d’organiser une fiesta électorale. Le résultat de la consultation tenue en avril, fut que le PSJ s’affirma comme le plus grand parti national et il forma avec le parti démocrate – et la bénédiction de MacArthur – un gouvernement de coalition dirigé par le socialiste Katayama.
On peut dire que grâce au gouvernement « socialiste », le patronat japonais réussit à faire table rase du peu que le prolétariat avait réussi à obtenir grâce à la désorganisation de l’appareil d’État consécutive à la défaite, désorganisation qui en 1947 n’était pas encore surmontée. Vers la fin de 1946, le patronat avait dû concéder dans les faits une certaine réglementation des critères de paiement des salaires. Selon l’accord obtenu alors, un niveau de vie minimum devait être « garanti », selon l’âge (les salaires devant être plus élevés pour les ouvriers les plus anciens), avec des mesures pour la famille, l’ancienneté, etc. Une partie des salaires devait correspondre à l’habileté au travail, et l’accord réaffirmait en outre la distinction entre travailleurs « à vie » et « temporaires ». C’était en fait une réédition du vieux système de l’ancienneté qui avait guidé jusqu’alors les rapports des ouvriers dans l’entreprise.
Evidemment un système de salaire de ce type avait le plein accord du patronat, non seulement parce qu’il accentuait la division parmi les travailleurs, mais aussi parce qu’il laissait une large marge de manœuvre pour les variations de salaire. De plus le gouvernement Katayama réussit à aggraver la situation en fixant un minimum de salaire très bas alors que l’inflation galopait. Le cabinet « socialiste » ne perdit pas une occasion pour mettre les bâtons dans les roues de la Sambetsu et pour favoriser clairement la Sōdōmei.
En résumé, pendant les neuf mois de son existence, il se montra le soutien le plus efficace des intérêts de la reconstruction capitaliste.
Le ministère suivant, toujours de coalition entre démocrates et socialistes, mais dirigé par le démocrate Ashida, continua à merveille l’œuvre de préparation des conditions nécessaires à la reconstruction : « ordre » dans les usines, interdiction de grève dans les services publiques, etc. Au plus grand déshonneur de la Sambetsu il faut noter que, malgré le caractère nettement anti-prolétarien du gouvernement Katayama, la fédération « de gauche » se crût obligée de s’opposer à sa chute par une agitation dans tout le pays.
Le gouvernement Ashida tomba à la suite d’un scandale et il fut remplacé par un gouvernement conservateur dirigé par le libéral Yoshida, chargé de traiter les affaires courantes et de préparer de nouvelles élections. Celles-ci eurent lieu à la fin de janvier 1949 et elles se soldèrent par une chute retentissante des socialistes et un renforcement notable du PCJ. Mais le résultat le plus tangible fût la position dominante de la droite. Yoshida forma un nouveau gouvernement qui, étant donné la démoralisation des masses ouvrières qui s’étaient senties flouées par la gauche (d’ailleurs en crise), put enfin procéder à un encadrement décisif du prolétariat et de ses organisations . Déjà sous Ashida avait débuté la tendance dans les entreprises à débarrasser des postes de travail les ouvriers les plus récalcitrant aux nécessités de la reconstruction. Mais sous Yoshida, dont l’autorité venait de se renforcer grâce au financement américain du plan Dodge (un plan Marshall à la mesure du Japon) et grâce à l’appui ouvert du SCAP, le procédé prît des dimensions plus massives. Dans la seule année 1949, 435 465 travailleurs furent chassés de leur emploi et presque autant l’année suivante (les travailleurs de la National Railway Workers Union, colonne vertébrale de la Sambetsu furent particulièrement touchés)[5].
En même temps se créait dans la Sambetsu des cellules « jaunes » (dites « ligues démocratiques ») pour détruire l’influence des ouvriers les plus combatifs et des « communistes ». Dans l’état de prostration où étaient tombés les ouvriers et grâce aux mesures que prit alors le SCAP pour frapper les délégués syndicaux à temps plein (on leur interdisait par exemple de continuer à toucher leur salaire), la manœuvre réussit.
Naturellement, il ne faudrait pas prendre ce processus pour la destruction d’un mouvement de classe (qui n’a jamais existé), mais il faut le comprendre comme l’expression d’un mouvement de la classe dominante pour se débarrasser de tout obstacle à l’exploitation élevée qui était nécessaire à la reconstruction rapide de l’appareil industriel et de l’économie nationale en général. A ce propos, un des objectifs fondamentaux du patronat était de rétablir une complète mobilité de la main d’œuvre. L’effort pour contrôler le mouvement syndical allait de pair avec l’extension dans les années suivantes du nombre de travailleurs « temporaires » et la réduction des « stables », dans le but évidemment de maintenir la pression sur les salaires.
L’acharnement anti-communiste particulier avec lequel fut impulsé la campagne pour instaurer un ordre rigide dans les usines ne se justifie pas par un reste de positions classistes du PCJ, mais découle plutôt de la situation internationale et des choix politiques extérieurs du Japon. De façon sommaire, la question se posait en ces termes : 1948 était l’année de la rupture entre les grandes puissances sur le problème de Berlin (et le « plan Dodge » est de 1948). En 1949 se termine victorieusement la « grande offensive » de Mao en Chine, en 1950 éclate la guerre de Corée, conséquence des divergences entre l’URSS et les USA en Orient. Après la faillite de la politique américaine de soutien au Kuomintang en Chine, et étant donné le conflit Seoul-Pyongyang, le Japon, selon les USA, devait devenir le bastion « anti-communiste » (lisez anti-russe) du Sud-Est asiatique en raison de l’énorme importance stratégique de l’archipel nippon pour les opérations militaires en Corée.
Les américains, en somme, avaient toujours plus intérêt à promouvoir le Japon de simple territoire occupé en allié indéfectible et super-contrôlé[6]. Parallèlement, la bourgeoisie japonaise trouvait dans le début de la guerre froide une chance inespérée de renaissance tant du point de vue politique qu’économique : d’un cote elle pouvait faire repartir à grande échelle l’industrie grâce aux commandes de guerre, aux « aides » et aux dollars fournis par les USA, de l’autre elle pouvait se « réhabiliter » politiquement et gagner une certaine marge d’autonomie en appuyant le puissant allié.[7]
Si les purges des ouvriers les plus combatifs s’accompagnèrent de celles des membres du PCJ, c’était donc en raison d’une conjoncture internationale bien précise : l’ »anti-communisme » devenait le ciment idéologique de la classe dominante obligée de détruire toute entrave parmi les forces institutionnelles à son choix de politique extérieure et tout obstacle, même minime, à la reprise impétueuse de l’accumulation d’après-guerre[8].
L’évolution ainsi décrite atteignit son point culminant dans la formation d’une nouvelle fédération, largement basée sur les « ligues démocratiques » : la Sōhyō (juillet 1950), clairement liée à l’AFL-CIO américaine de Georges Meany. A la suite de cette naissance, la Sambetsu vit s’accélérer son déclin jusqu’à sa dissolution en février 1958.
Un des objectifs fondamentaux de la politique patronale était de recréer ad hoc une large division entre travailleurs stables et travailleurs temporaires et, du même coup, obtenir une grande liberté sur la main d’œuvre pour réglementer les conditions de travail, en particulier pour la petite et moyenne industrie. On ne peut certainement pas dire que la Sōhyō ait fait beaucoup contre ce moyen fondamental de division de la classe ouvrière entre une mince couche aristocratique et de larges masses surexploitées privées de la sécurité du poste de travail et soumises à la menace du chômage. Ainsi les organisations affiliées à la Sōhyō acceptèrent que cette division devienne la base de l’organisation syndicale, en refusant l’adhésion à celle-ci aux travailleurs temporaires et en s’abstenant soigneusement de toute politique en faveur des prolétaires de la petite et moyenne industrie, qui furent toujours au contraire abandonnés à eux mêmes. Ainsi la Sōhyō refusa toujours d’accepter dans ses rangs les membres d’organisations radicales comme la Hansen Seinen Iinkai[9].
Comme nous le verrons sa fonction sera d’assurer l’intégration de la classe ouvrière dans l’édifice du capitalisme national, en s’appuyant essentiellement sur les couches les plus privilégiées, réalité qui ne fut guère modifiée ni par l’influence conquise finalement par les « communistes » ou les (aujourd’hui tout-à-fait majoritaires), ni par la pratique des « offensives de printemps » (instituées en 1955). Ces « offensives de printemps » ont pour but de stabiliser les augmentations de salaire et de négocier les conditions de travail pour des millions de travailleurs de diverses catégories, ce qui n’est qu’un dépassement apparent de l’organisation sur une base d’entreprise de la Sōhyō (d’autant plus que comme il a déjà été dit[10] l’histoire des syndicats japonais dans le second après-guerre forme une ligne continue avec celle de la période de guerre, la période de la tristement célèbre Sampō).
Mais il est intéressant de noter que, en dépit du caractère ouvertement collaborationniste de la Sōhyō, le patronat, en 1960, impulsa de nouveau la création d’une fédération syndicale « jaune », la Dōmei[11] qui est aujourd’hui la deuxième organisation syndicale japonaise et la première dans l’industrie devant la Sōhyō qui a ses bastions dans les services publiques. L’aversion du capital japonais pour toute organisation syndicale, même collaborationniste, mais assez forte pour dominer le monde du travail, témoigne éloquemment de ce que la période de reconstruction, jusqu’à la fin des années 60, a été au Japon une période de sur-exploitation anarchique et illimitée de la classe. Elle indique aussi à quel point celle-ci a été pliée aux exigences de l’industrie jusqu’à rendre superflue pour la contrôler une imitation même purement formelle du syndicalisme de classe, ce là dans la Dōmei, mais aussi, dans une forme plus voilée dans la Sōhyō.
L’histoire syndicale japonaise du deuxième après-guerre place les organisations ouvrières à un niveau intermédiaire entre la phase de développement des syndicats américains et celle des syndicats européens dans la même période historique, dans le sens que les « unions » associent une structure à base d’entreprise qui comprend presqu’exclusivement (mais pas totalement) les couches les mieux rétribuées du prolétariat (type AFL-CIO américaine), une pratique et quelques usages, par exemple les « offensives de printemps » conduites par secteurs, analogues à celles existantes en Europe (voir les « autonomes » italiens ou les revendications de certains secteurs en Angleterre).
Mais parler de cette phase de développement comme d’une transition entre la forme américaine et la forme européenne[12] signifie banaliser la particularité du syndicalisme nippon et cacher sous la forme, un problème de fond. De la même manière on pourrait dire que les syndicats européens (nous pensons aux italiens et aux français plus qu’aux anglais) vivent une transition qui les rapproche progressivement d’une forme « japonaise » étant donné la tendance marquée à la cogestion dans leur programme comme dans la réalité.
Il s’agit en réalité du processus typique de l’époque impérialiste de l’intégration progressive des syndicats dans l’appareil d’État bourgeois et de leur identification toujours plus marquée aux intérêts et aux impératifs de l’économie nationale avec toutes les conséquences que cela entraîne, soit sur le plan de l’entreprise (collaboration y compris administrative avec la direction en s’appuyant sur les travailleurs des catégories les plus élevées), soit sur un plan plus général, celui sur lequel les confédérations assument toujours plus le rôle de parti bourgeois du travail, ce que le fascisme avait réalisé d’autorité avec l’institution des corporations de travailleurs.
Dans cette optique disparaît la contradiction apparente entre la base de l’entreprise de la politique syndicale (reflet essentiellement du fractionnement de la classe dans l’unité économique bourgeoise : l’entreprise) et les initiatives « politiques » ou les revendications défendues par les syndicats (mais toujours sur la base de la compatibilité économique indiquée par le cadre institutionnel) pour réguler et amortir dans l’intérêt général des conflits du travail et les excès les plus évidents de l’exploitation capitaliste (essentiellement dans la grande industrie, beaucoup moins pour la petite industrie et pas du tout pour le vaste secteur du travail au noir).
Dans ce sens il est secondaire, même si ce n’est pas indifférent, de définir quel est celui des deux aspects caractéristiques des syndicats de l’époque impérialiste qui prédomine à un moment donné de leur évolution. Au Japon, on a eu en fait une évolution qui, partant de la « floraison » de l’immédiat après-guerre, avec une grande croissance du nombre de syndiqués, y compris dans les couches les plus basses, est passée par une pression sur les « unions » afin d’atomiser toute leur action, de répudier les couches les plus exploitées, d’acquérir la souplesse d’entreprise nécessaire aux exigences patronales. Par la suite, avec la contradiction Dōmei-Sōhyō, le besoin d’une pratique de collaboration sociale à un niveau plus élevé et plus complet est devenu manifeste pour arriver à contrôler de façon plus satisfaisante les rapports entre capital et travail après l’affirmation du plein contrôle patronal sur la vie syndicale dans l’usine. Si donc on peut parler d’une « phase japonaise » particulièrement dans le développement des rapports syndicats-États, c’est dans le sens d’un stade d’évolution particulièrement avancé du point de vue impérialiste, au moins comme un « modèle idéal » étant donné que la grande tradition syndicale en Occident et en Europe, la « compétence » particulière acquise par les grandes fédérations dans le développement politique général, font des syndicats un formidable outil de la politique bourgeoise du travail .
Sans aucun doute, la situation syndicale du Japon (pour laquelle la bourgeoisie a su utiliser les expériences les plus « utiles » de l’Occident)[13] apparaît comme un facteur essentiel de la paix sociale, au point que le prolétariat, une fois revenu sur la voie de la lutte indépendante, ne pourrait guère rêver d’utiliser d’une façon ou d’une autre ses méandres, même après la chute politique de la honteuse bureaucratie qui en monopolise aujourd’hui tous les mécanismes et structures[14].
Si, dans notre analyse de la classe ouvrière japonaise, nous nous limitions à la notion de prolétariat industriel, nous commettrions une erreur encore plus grande que pour d’autres pays industriels. Le Japon, comme l’Italie, a un secteur très important d’économie immergée de travail au noir et présente un fort éparpillement productif. Ces traits ont toujours été considérés dans les études comme plus ou moins typiques du « modèle de développement » à la japonaise.
Dans l’immédiat après-guerre le pourcentage des actifs employés dans l’agriculture était encore élevé pour un pays capitaliste (40 %), ce qui s’expliquait par le caractère récent du développement capitaliste nippon. A partir de la deuxième moitié des années cinquante, l’exode rural, déjà commencé avant la guerre, pris des proportions impressionnantes en raison de la puissante reprise du procès d’accumulation. A la suite de la Loi Fondamentale sur l’Agriculture de 1961 instaurée pour lubrifier les transferts de main-d’œuvre du secteur agricole au secteur industriel et pour élever la surface moyenne des lopins de terre en favorisant les grandes entreprises capitalistes, l’exode devient une véritable migration de masse : en 10 ans (de 1961 à 1971) les travailleurs agricoles diminueront de huit millions. Pour apprécier l’ampleur du phénomène, il faut observer que sur les 6 à 7 millions d’actifs dans l’agriculture à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, au moins 4 millions avaient une autre occupation régulière. A l’évidence, ce « deuxième travail », les agriculteurs ne pouvaient le trouver que dans l’industrie (surtout la petite industrie manufacturière) vis-à-vis de laquelle ils constituaient une armée industrielle de réserve extrêmement mobile et manœuvrable.
« Il ne reste à la maison que les femmes et les vieux de plus de 60 ans qui constituent en fait 70 % de la force de travail agricole » (J. Halliday, op.cit., p 202).
En 1960 le revenu de la famille agricole ne provenait que de 55 % du travail de la terre; au début des années 70, ce pourcentage s’était réduit de moitié ![15]
Cette brève illustration sert à comprendre jusqu’à quel point et dans quelles couches de la population les rapports de production sont devenus, de diverses manières, des rapports de travail salarié, et à l’inverse quel est le degré de fragmentation de « l’armée industrielle » (régulière et de réserve).. Et il est clair qu’en période de boum économique, comme celle des 30 années suivant la guerre, ce dernier aspect prévaut, tandis que c’est seulement dans une période de crise profonde, prolongée et aiguë, que les prolétaires pourront réellement prendre appui sur leur concentration pour attirer à la lutte les vastes couches semi-prolétariennes.
La relative soumission (tellement admirée par la presse occidentale) du monde du travail japonais a été indubitablement un des facteurs qui ont facilité la rapide renaissance du capitalisme à des niveaux supérieurs aux précédents. Mais une telle subordination ne peut s’expliquer uniquement par des raisons sociales et politiques. Certes, les conditions particulières d’« impérialisme occupé » ont influé sur le moral de l’ensemble du prolétariat. Certes l’organisation politique japonaise actuelle, y compris les syndicats, est au fond un produit de la période du SCAP, et les partis « ouvriers » entièrement situés sur le terrain national et institutionnel on été un puissant facteur[16] de stabilisation. Dans les syndicats enfin, les prolétaires n’ont pas trouvés d’organisation indépendante (non seulement la Sōhyō et la Dōmei ouvertement jaune ne sont pas essentiellement différentes, comme on l’a vu, mais à partir des années soixante-dix, elles ont collaborées entre elles de différentes façons)[17].
Il n’est pas moins vrai qu’une autre raison fondamentale de l’attitude « responsable » (ce qu’il ne faut pas prendre tout-à-fait à la lettre comme le fait de manière intéressée la presse bourgeoise) du prolétariat japonais est à rechercher dans la progression constante et rapide de son niveau de vie après la « guerre du Pacifique », de même que chez nous en Europe, l’âge d’or du « néo-capitalisme » ouverte avec la phase de reconstruction avait fait proliférer, au moins jusqu’a la fin des années soixante, les théorisations d’un capitalisme capable de fournir un progrès illimité et de faire disparaître toutes ses contradictions. Mais au Japon, le phénomène a revêtu quelques aspects particuliers, que ce soit le niveau extrêmement bas (par rapport aux autres pays industrialisés) du niveau de vie d’origine de la population ou l’augmentation plus grande du « bien être » (c’est-à-dire du pouvoir d’achat des salaires).
En somme, dans les années soixante, en raison de l’augmentation des salaires et de l’amélioration des conditions de vie, en raison de la quasi-absence de chômage (en rapport avec la véritable « faim » de main d’œuvre de l’insatiable industrie en pleine expansion), ou par suite du manque d’organisations à traditions classistes, le Japon a connu quelque chose qui ressemble fort à l’idéal de Paix Sociale auquel rêve le capital occidental. Grosso modo, les luttes ouvrières se sont limitées aux « offensives de printemps » et à quelques autres manifestations sporadiques à caractère politique, totalement inspirées et contrôlées par la gauche officielle (comme l’opposition au traité de sécurité avec les USA et aux conditions de restitution de l’île d’Okinawa) .
Il est cependant évident, étant donné que l’on note ces dernières années un certain réveil des luttes ouvrières, que même alors, les choses ne pouvaient être aussi simple qu’elles apparaissaient. Ainsi le formidable développement même du capital à un rythme aussi rapide et dans un temps aussi bref a créé tout aussi rapidement les conditions d’un renversement de la situation qui ne pourra pas ne pas se produire avec l’aggravation de la crise, crise que le Japon par sa faiblesse relative, par sa subordination aux USA et par sa dépendance pour les matières premières, est condamné à payer plus cher que les autres impérialismes. Dans une période comme actuellement, marquée par la crise économique internationale, la concurrence commerciale exacerbée, la course à l’accaparement des matières premières, la stagnation mondiale des investissements, le protectionnisme renaissant, une furieuse guerre monétaire, le Japon de la Paix Sociale est destiné à devenir le théâtre de violents conflits sociaux. Pour survivre à toutes ces pressions, son capital devra engager, à côté de la lutte contre les concurrents, une lutte autrement plus féroce contre la classe ouvrière pour démanteler les relatives conquêtes obtenues au moment du boum économique.
Certes le capital japonais possède dans la confrontation un avantage énorme sur le prolétariat : bien qu’il soit le dernier arrivé dans le club des « riches », ou peut-être précisément pour cette raison, il a pu acquérir (et le rôle de la « démocratisation » made in USA a été de ce point de vue très importante) tout l’héritage des classes dominantes les plus expérimentées, un système politique complexe et solide, une concentration financière et industrielle extrême, une intégration poussée des organisations économiques du prolétariat dans l’État. Mais les digues érigées pour prévenir les conflits de classe révèlent déjà une indiscutable fragilité : en l’espace d’une génération , des millions de japonais ont connu un bouleversement exceptionnel de leurs habitudes de vie et des rapports sociaux antérieurs (par exemple entre ville et campagne). Cette génération n’a pas encore passé la main que déjà s’entrevoient les prémisses d’un futur bouleversement, celui des mythes de la société de bien-être à peine adolescente et des institutions essentielles sur lesquelles reposait sa crédibilité, comme le « seniority system », sérieusement mis à mal en cas de récession prolongée[18]. Il arrivera donc le temps où l’énorme concentration de la classe ouvrière – surtout dans la gigantesque zone industrielle qui va de Tokyo à Osaka – fera sentir son poids énorme dans des conflits qui seront d’autant plus âpres que le prolétariat est moins pourvu de « garanties sociales » en tout genre que son homologue occidental.
Si on considère que la poussée démographique japonaise envoie chaque année en moyenne un million à un million et demi de jeunes sur le marché du travail et que de 1950 à 1970 la population a augmenté de 20 millions de personnes, ces huit millions de travailleurs qui ont quitté l’agriculture constituent un chiffre colossal et un indice sûr de la voracité insatiable de l’industrie : au cours de ces 20 années-là, la main d’œuvre a augmenté de 10 millions dans l’industrie et de 14 millions dans le secteur tertiaire.
C’est l’explication fondamentale de la dynamique élevée des salaires qui a caractérisé l’économie dans les années soixante, définie comme l’époque de « pénurie » (évidemment relative) de la force de travail dans un pays qui a dépassé les cent millions d’habitants ! La pénurie, évidemment, touchait surtout la force de travail qualifiée, parce qu’en réalité, le capital japonais après le bouleversement de l’économie agricole, a joui au contraire d’une surabondance de bras à bon marché et est ainsi arrivé à se constituer une véritable « armée de réserve industrielle » de sous-occupés. En 1968 encore, les salariés des petites entreprises ne gagnaient que 58 % du salaire de leurs collègues plus chanceux des grandes industries. Si on se souvient que cette même année, la moitié des travailleurs de l’industrie étaient employés dans des entreprises de moins de cent personnes, et plus d’un quart dans des établissements de moins de vingt personnes, on comprend à quel point est exacte l’opinion de Sautter[19] :
« la rémunération des travailleurs non qualifiés de l’industrie ne suit pas la même loi statistique que celle des travailleurs qualifiés ».
Comme les autres pays industriels, mais à un degré supérieur en raison du pourcentage encore relativement bas des travailleurs industriels par rapport au reste de la population (2/3 en 1970), le Japon présente donc un marché du travail à caractère dualiste, dans lequel, à côté d’une aristocratie ouvrière assez restreinte (en tenant compte des différenciations à l’intérieur des grandes entreprises)[20], on voit une large couche du prolétariat exclu en tout ou en partie des « privilèges » de la société « de consommation ». Mais la demande de bras est telle qu’à partir de la deuxième moitié des années soixante, les salaires moyens des travailleurs des petites et moyennes entreprises ont crû à un rythme parfois plus rapide que ceux des grandes entreprises, ce qui a réduit les écarts de salaire (encore importants toutefois) et qui a diminué la marge de manœuvre du capital sur le vaste marché du travail. Et cela bien que les travailleurs japonais aient en moyenne l’horaire de travail le plus élevé des pays industrialisés (en 1986, l’horaire annuel du travailleur industriel japonais était de 2156 heures, tandis que celui du travailleur allemand était de 1708, soit 25 % de moins, celui de l’ouvrier français de 1771 heures et de l’américain de 1913 heures).
Sautter explique la dynamique exceptionnelle des salaires dans la deuxième moitié des années soixante (15,1 % d’augmentation), c’est-à-dire au moment du second boum des investissements après la pause de la première moitié de la décennie (le premier boum ne s’était accompagné que de 8,5 % d’augmentation), par cette phrase :
« l’extrême flexibilité des salaires japonais a disparu en même temps que le surplus de main d’œuvre jeune »[21].
L’essence de son argumentation, exagérée mais symptomatique, est que :
« à considérer seulement le marché du travail, le Japon présentait les caractéristiques d’un pays sous-développé jusqu’en 1960 »[22].
Sans reprendre l’idée d’une telle coupure entre les années cinquante et soixante, il est clair que, comme nous l’avons toujours soutenu, le Japon ne doit pas être considéré comme un étrange « animal » économique, tout-à-fait différent de l’occident, mais comme un capitalisme plus récent, parti donc de niveau de salaire très bas avec une surabondance de main d’œuvre à bon marché issue de la campagne, extrêmement misérable, au point que les paysans devaient vendre leur lopin pour assurer tant bien que mal leur vieillesse, après une vie de labeur et de sacrifices inouïs pour ne pas s’en séparer.
Mais le Japon n’est pas si jeune qu’il puisse échapper aux maux de la société industrielle avancée. A partir des années soixante sa position avantageuse va s’éroder, ce qui n’est guère surprenant dans un pays où, depuis la restauration de Meiji, tout semblait galoper à bride abattue, à commencer par la transformation des habitudes de vie.
Du reste, ce n est pas seulement dans la lointaine île du soleil levant qu’on assiste dans la seconde moitié des années soixante à une amélioration considérable des conditions de vie de la classe ouvrière et à une forte baisse du taux de chômage. Deux décennies d’expansion ininterrompue avaient mis entre les mains des travailleurs de divers pays une certaine force de négociation sans même se placer sur le terrain d’un lutte de classe résolue, et du point de vue des capitalistes, des marges de profit suffisamment grandes pour pouvoir distribuer des miettes qui, dans certains cas (comme pour les couches les plus élevées du prolétariat) étaient même assez consistante. Il est important de souligner cependant que le Japon a maintenu un certain avantage sur ces concurrents étant donné que si le salaire direct a quasiment rejoint le niveau occidental, le salaire indirect (c’est-à-dire l’assistance sociale maladie, vieillesse, allocations chômage, etc.) reste nettement inférieur.
Quels ont été les retentissements de ces tendances sur les institutions de la paix sociale japonaise ?
En apparence, au moins jusqu’à la première moitié des années soixante-dix, non seulement le système à tenu, mais il a pu fonctionner comme un véritable régulateur social. Mais à regarder les choses de plus près, il est possible de percevoir quelques contradictions qui, sans être décisives et sans remettre pour le moment en cause la portée du « seniority system », montrent que les choses pourraient changer en période de crise.
Le « seniority system » se compose de deux institutions techniquement distinctes, mais qui forment à elles deux un unique et puissant instrument du consensus : l’emploi à vie et la rétribution à l’ancienneté.
La première garantit au jeune japonais sorti de l’école qui a eu la chance (il n’y a pas d’autre possibilité parce que l’industrie n’embauche que des jeunes venant d’être diplômés de différentes écoles) de se faire engager par de grandes entreprises, donc d’avoir un contrat stable (car même dans ces grandes entreprises il existe quantité de contrats temporaires, de stagiaires, etc), de jouir toute sa vie de la sécurité de l’emploi, puisque même si la production baisse temporairement, l’entreprise ne le licenciera pas ni ne suspendra son salaire .
Il est clair que la rigidité de ce type de travailleurs aristocratiques ne peut exister sans l’extrême mobilité du prolétariat moins avantagé dans les 'mêmes grandes industries ou dans les petites entreprises. Ce sont les deux face d’une même médaille.
Dans les périodes difficiles les entreprises les plus petites qui vivent à l’ombre des grandes (qu’elles soient sous-traitantes, ou que comme une part non négligeable d’entre elles, elles travaillent pour l’exportation) licencient une partie de leur personnel ou font faillite. Le géant lui survivra ! Si la situation est vraiment grave, la grande entreprise pourra commencer à se libérer de la main d’œuvre non qualifiée ou à ne pas renouveler les contrats temporaires, etc. Dans les cas les plus désespérés, il existe toujours l’échappatoire de la faillite, une autre institution sacrée au Japon où, à cause du très haut degré d’endettement des entreprises mais aussi en raison de ce système d’ancienneté, elle fonctionne comme nulle part ailleurs. Nous voyons donc que la sécurité à vie de l’emploi n’est pas tout-à-fait absolue, même si en temps normal, le travailleur privilégié est à l’abri des fluctuations du marché et, dans une certaine mesure, des crises de brève durée. Naturellement le travailleur qui jouit de cette « garantie » le paie de la séparation d’avec ses camarades de travail moins privilégié et d’une fidélité totale à l’entreprise. Ce sont bien sûr les travailleurs non garantis qui supportent tout le poids de cette situation.
Quant à la rétribution à l’ancienneté, elle n’est pas inconnue en occident, mais elle a au Japon une application plus étendue et plus rigide : les augmentations suivant l’ancienneté sont beaucoup plus fortes et la paye de départ beaucoup plus basse et même extrêmement basse pour les titulaires de diplômes plus élevés. Le travailleur est ainsi contraint au début aux heures supplémentaires et à une loyauté totale qui lui « rapportera » des années plus tard.
Il est intéressant de noter que ce système apparaît d’une certaine façon comme une survivance du corporatisme de l’industrie, protégée à sa naissance par l’État, qui, grâce à l’expansion économique continue, a pu, sous une forme presqu’immuable, changer graduellement de contenu pour devenir une institution du capitalisme dans sa phase impérialiste, l’institution de l’aristocratie ouvrière qui garantit de façon incomparable la paix sociale (en s’accompagnant de la collaboration par l’intermédiaire des forces de gauche, des organisations ouvrières avec l’État).
Mais le système ne pourra conserver son ampleur actuelle, en raison de la déqualification des tâches dues aux progrès technologiques ou d’autres contradictions. Désormais le capitalisme japonais ne s’intéresse plus, sinon d’un point de vue politique, au « professionnalisme » et à la « loyauté » toujours relative, mais plutôt à la mobilité et à la « fraîcheur » du prolétariat.
Dans la deuxième moitié des années soixante, la relative pénurie de main d’œuvre jeune entraînait une tendance à la réduction de l’éventail des salaires entre petites et grandes entreprises, entre jeunes et vieux travailleurs, alors qu’une surabondance de jeunes dans les années soixante-dix devait entraîner à la longue une tendance apparemment inverse, mais dont la signification générale est identique : en temps de crise économique, la rigidité du travail devient un boulet au pied du capitalisme et si les premiers frappés sont les non garantis, en cas de stagnation ou de crise de plus grande ampleur, des couches toujours plus larges de travailleurs doivent être attaquées.
Un premier coup porté au « seniority system » est venu à l’époque du boum économique, de l’épuisement du « parc » des travailleurs jeunes et qualifiés; une autre tendance minant le système par l’inversion de la courbe démographique. Un rapport de 1977 dénonçait le phénomène ainsi (extrait de « Notizie dal Giappone », mai 77) :
« Le rapide vieillissement de la population et la rapide diffusion de l’instruction sont destinés à influer sur la structure de l’entreprise pour ne pas dire de tout le système salarial. A ce sujet, le rapport provisoire prévoit que les systèmes salariaux basés sur l’ancienneté, fréquents au Japon, seront complètement restructurés dans un avenir pas trop lointain. En quelques mots, tant que la courbe de la population en fonction de l’âge avait une structure avec une base pyramidale large, le système de l’ancienneté assurait aux entreprises un coût salarial relativement bas et aussi une organisation stable du point de vue social. Dans la société de l’an 2000 un tel système ferait monter les coûts salariaux. Pour cette raison les entreprises seront contraintes à changer le système, parce qu il est toujours plus difficile de supporter l’augmentation correspondante des coûts salariaux.
A l’appui de cette analyse le rapport indique que se manifestent déjà des signes de désaffection vis-à-vis du salaire à l’ancienneté. Par exemple, bien que la population entre 50 et 59 ans ait atteint le plus haut niveau de salaire au début des années soixante, les salaires avaient cessé de progresser entre 35 et 39 ans et avaient commencés à descendre réellement pour les salariés âgés de plus de 50 ans. En outre les différences de salaire suivant l’âge s’étaient considérablement restreintes.
En l’an 2000, la force de travail comprise entre 45 et 64 ans dépassera celle comprise entre 25 et 44 ans. Il n’y a aucun doute qu’a la suite de cette mutation, l’équilibre actuel entre dirigeants et dirigés sera bouleversé. Et particulièrement il sera presque impossible d’absorber la plus grande partie des personnes entre 50 et 54 ans qui passeront de 4,4 millions à 8,2 millions en l’an 2000. »
Il est donc clair, et encore plus en période de crise économique, que les institutions sociales ainsi enracinées au Japon sont destinées à recevoir des coups continuels qui pousseront les autorités à démanteler les « garanties » des couches aristocratiques toujours plus vaste du prolétariat. Il s’en suit que des troubles sociaux aigus et profonds ne manqueront pas de survenir; un des facteurs de cette évolution sera l’écroulement du mythe de « l’emploi à vie ».
Nous avons déjà parlé du bas niveau des salaires indirects japonais en comparaison avec les autres pays industrialisés. Voilà un indice clair de l’importance des problèmes relatifs à l’assistance sociale (maladie, vieillesse, chômage, etc).
Si la situation n’est pas particulièrement grave, toujours par rapport aux autres pays, en ce qui concerne l’assistance sanitaire où une grande partie de la population est couverte par les organismes publics (mais ne reçoit pas plus de 70 % du remboursement des frais médicaux pour les travailleurs indépendants et la famille des travailleurs non indépendants qui seuls reçoivent le remboursement total, et sans parler des travailleurs irréguliers), les choses sont pires pour les autres formes d’assistance : le mécanisme d’aide aux chômeurs est en pratique dérisoire , le système de retraite ne garantit pas dans les faits une vieillesse tranquille. Pour jouir de la retraite, il faut avoir travaillé ou versé des cotisations pendant 20 ans au moins. En plus, bien qu’au moment de la cessation du travail (la limite d’âge est de 60 ans, mais habituellement les femmes doivent arrêter le travail vers 30 ans et les hommes vers 55 ans) on verse au travailleur qui a eu la chance d’avoir un travail régulier un solde égal à une mensualité par année de travail (soit de 20 à 40 mois de salaire), l’inflation et le fait que la pension commence à être versée à 60–65 ans contraint beaucoup de vieux travailleurs à la recherche angoissante d’un nouveau travail. De plus les japonais sont obligés de faire beaucoup de sacrifices pour faire face à une partie de dépenses de santé, pour l’instruction des enfants, pour un logement digne de ce nom (dont les loyers sont supérieurs à ceux des pays industrialisés), pour la vieillesse et pour faire face à l’inflation qui ronge les économies et contraint à épargner toujours plus[23]. Rien d’étonnant à ce que les parents comptent généralement sur leurs enfants pour les entretenir durant leur vieillesse et qu’une revendication qui a tendance à se propager est celle du recul de l’âge de la retraite… .
Le taux d’épargne des japonais est très élevé par rapport aux autres pays capitalistes et la raison n’est pas difficile à trouver. Une de ses principales destinations est la réalisation du rêve d’un logement moins étroit et plus commode. Les destructions de la guerre, puis la forte urbanisation et la grande concentration métropolitaine (la population urbaine a augmenté de 15 millions de 1960 à 1970) jointes à l’étroitesse du territoire disponible, facteurs auxquels se superpose une spéculation effrénée, rendent l’acquisition d’un minuscule logement ou le paiement sans problème du loyer, particulièrement difficiles. Les appartements en plus sont peu solides, ont souvent cuisine et toilettes en commun; et en ville leur surface moyenne est de… 17 m2. Il semble incroyable que dans ces conditions les plus épouvantables mégalopoles nippones soient les plus tranquilles du monde et qu’elles aient un taux de délinquance très faible. Mais les choses ne tarderont pas à changer !
Pour donner une idée de l’entassement des zones industrielles, voici un exemple suggestif : les trains de la métropole (dont la capacité maximum a été définie par le ministère des transports à 100 personnes par voiture) se remplissent aux heures de pointe à 250–300 personnes par wagon, grâce aux célèbres « pousseurs » destinés à compresser la force de travail dans ces véritables containers de chair humaine.
Nous ne parlerons pas de la ruine écologique et de la souillure de beaucoup de régions ou de zones maritimes, toutes choses pour lesquelles le Japon est proverbialement connu (rappelons qu’il existe à Tokyo des distributeurs d’oxygène à jetons).
Pour terminer sur la question des salaires, relevons une autre particularité du système salarial, très enviée par les concurrents du Japon, et qui risque de rendre la situation des travailleurs très difficile en temps de crise : une partie très importante du salaire (jusqu’a 40 %) se trouve sous forme de primes semestrielles indexées sur les profits de la période précédente. On comprend facilement que lorsque les profits de l’entreprise se réduisent, comme actuellement, ou lorsqu’il y a des pertes, la rémunération de la force de travail tend à se dégrader rapidement.
C. La détérioration des conditions de vie du prolétariat a partir des années 70
[prev.] [content] [next]
Dès le début des années 70, la classe ouvrière japonaise assiste à l’affaiblissement progressif du mythe de la société de « bien être » consécutif à la détérioration croissante des conditions de vie. C’est en 1969 en fait que commencèrent les premières mesures et pressions américaines contre l’invasion du « made in Japan ». En octobre 1971, les manœuvres américaines aboutissent à un résultat important en contraignant les japonais à accepter de très sévères restrictions à l’importations de produits textiles : on a estimé à environ 300 000 le nombre de chômeurs qui résultèrent de ce premier coup annonciateur de l’avenir, étant donné la complémentarité des marchés japonais et américains et le fait que ce dernier constitue depuis longtemps le meilleur débouché des marchandises japonaises, ce qui rend le Japon très vulnérable au protectionnisme américain.
Par la suite, les japonais sont contraints à une longue série de reculs en matière économique et commerciale qui atteignirent leur sommet lors de la crise économique de 74–75 et qui, après le choc pétrolier de 73–74 ont contribué à recréer de pénibles conditions d’insécurité pour les prolétaires.
En effet après 73, l’économie japonaise a définitivement perdu les sensationnels taux de croissance de l’époque antérieure (15–20 % par an dans l’industrie et 15 % en moyenne pour le PNB), qui même après la « reprise » japonaise de 76 furent réduits de plus de la moitié. Et même si le taux de croissance dans cette période reste enviable par rapport aux capitalismes plus anciens, il est sûr que le pays du soleil levant a oublié le « modèle de développement à la japonaise » pour se contenter du rythme caractéristique des vieux impérialismes avec chute du taux de profit, chute des investissements, ralentissement des taux de croissance.
La reprise qui a suivi la crise de 74–75 avait péniblement rejoint l’indice de production de 1973, point le plus haut du cycle précédent lorsqu’à éclaté la crise de 81–82. Si l’on s’en tient aux statistiques officielles, le taux de chômage reste cependant à un niveau très bas par rapport aux capitalismes concurrents (le « Report on the Special Labour Force Survey », cabinet du Premier ministre, donne des taux de chômage de 2,2; 2,5 et 2,6 % pour respectivement 1980, 81 et 82). Mais les statistiques du chômage au Japon ont peu de rapports avec celles des autres pays, en raison principalement de leur négligence de la situation dans les petites entreprises et selon les experts occidentaux, il faudrait les multiplier par deux pour avoir une image se rapprochant de la réalité. Si on se limite aux grandes entreprises, la Banque du Japon indique que 20 % de celle-ci estiment que le nombre de leurs employés est trop élevé, c’est-à-dire le même nombre qu’en 1975, après le choc pétrolier (OCDE, « Perspectives du marché du travail au Japon », juillet 1983). Si on se reporte aux chiffres de cette époque, on voit que la réduction de la main d’œuvre s’est étalée sur 5 ans pour les grandes entreprises : l’emploi y a chuté de 6,5 % entre 74 et 79.
La productivité a continué à croître alors que le taux d’utilisation des installations chutait de façon sensible (20 % en moyenne et plus encore dans certains secteurs). En clair cela signifie que l’ introduction de machines plus modernes s’est accompagnée d’une augmentation du taux d’exploitation de la main d’œuvre et d’une augmentation du chômage.
Et cela est si vrai qu’on a commencé alors à parler pour certains secteurs (métallurgie, construction, etc.) de la nécessité de se débarrasser avec l’accord du gouvernement et des syndicats, de la main d’œuvre excédentaire tandis que les milieux industriels devenaient de plus en plus partisans d’une modification du système d’emploi à vie, ou en tout cas de l’introduction de dispositions spéciales permettant à l’entreprise en difficulté d’éliminer les bras en surnombre.
Ainsi, en 1977, lors d’un ralentissement de la reprise, Fukuda lança, avec une série de mesures économiques contre la stagnation, la baisse du dollar par rapport au yen et la pression commerciale de la concurrence, une mesure d’assistance financière aux entreprises contraintes de suspendre le personnel en « surnombre » et un système de primes à la « mobilité du travail ».
Les chiffres sont d’ailleurs impressionnants; l’industrie manufacturière avait perdu 900 000 postes de travail. Le secteur des chantiers navals, autrefois un des piliers de l’économie, licencia des milliers de travailleurs et démantela une grosse partie des installations; il n’a jamais retrouvé des niveaux de production similaires à ceux d’avant la crise et il a définitivement perdu sa suprématie sur le marché mondial ces dernières années. Le secteur de l’acier, orgueil du Japon, avait du fermer le tiers de ses 68 hauts-fourneaux et licencier des dizaines de milliers de travailleurs. La situation était pire encore dans les secteurs textiles et pétro-chimiques; même l’industrie automobile avait ressenti le poids de la crise (24 000 emplois en moins en 4 ans).
Pour ce qui est des salaires, ils avaient connu des augmentations considérables en termes monétaires (mais beaucoup moins en termes réels) dans la deuxième moitié des années 60 et en particulier fin 74 au moment où « l’offensive de printemps » s’était traduite par une hausse record de 32 %. Mais grâce aux bons soins des syndicats, ils commencèrent à se réduire : en 75 et 76 les syndicats acceptèrent une conduite « responsable » des « offensives de printemps » et pour la première fois les augmentations de salaires furent inférieures à 10 %, inférieures en fait à l’augmentation des prix.
Du reste la Sōhyō ne fit pas preuve seulement de « responsabilité » sur le plan salarial, elle démontra aussi son respect pour les exigences du capital national et sa répugnance à défendre les conditions de vie et de travail du prolétariat. Les années 75 et 76, en pleine crise, furent exceptionnellement pauvres en grèves et en luttes (c’est dire !). La Sōhyō porte ainsi la responsabilité de la défaite de la lutte de 75 dans le secteur des transports pour le droit de grève, qui fut finalement interdit par la loi.
La reprise économique n’a guère amélioré la situation de la classe ouvrière, même si elle a permis d’éviter une dégradation brutale de son niveau de vie. Les économistes estimaient qu’en 1981 le Japon avait récupéré les effets de la crise de 74–75; le nombre d’emplois dans l’industrie était redevenu égal à celui de 1973 (tandis que la production, en volume, avait rejoint le niveau de 1973 dès 1979).
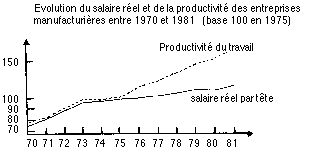 |
| Source : Economic Planning Agency. (D’après : « Le Japon : transformation industrielles, croissance et internationalisation », in « Economie Prospective International », No.15, 3ème trimestre 83.) |
Les chiffres officiels indiquent une augmentation du salaire réel par tête dans l’industrie de 1,9 % en moyenne de 75 à 81, en contraste marqué, il est vrai, avec la période précédente. De plus, ces faibles augmentations du salaire réel s’accompagnent d’une forte augmentation de la productivité du travail, c’est-à-dire du taux d’exploitation des travailleurs (voir tableau 1, ci-dessus).
Le maintien de l’emploi global cache de profondes évolutions. Un fait marquant est l’augmentation de la main d’œuvre féminine. Le nombre de femmes de 35 à 50 ans pourvues d’un emploi est passé de 16 % en 1960 à 36 % en 1980. Ces chiffres, qui sont des moyennes, ne signifient pas que la main d’œuvre féminine a perdu toute spécificité par rapport à la main d’œuvre masculine, bien au contraire. Le taux d’activité des femmes reste très variable suivant l’âge. Les statistiques de 1981 montrent qu’à 23 ans 70 % des femmes sont au travail (dont 63 % en entreprise); à 28 ans, elles ne sont déjà plus que 44 %. Après être tombé à un niveau très bas, le chiffre remonte à 64 % après la quarantaine. Cela permet déjà de comprendre qu’en vertu des règles de l’ancienneté, les femmes ne pourront espérer atteindre des niveaux de salaire équivalents à ceux des hommes : les jeunes femmes ne travaillent que quelques années avant de quitter leur emploi au moment du mariage; quand elles reviennent sur le marché du travail au moment où leurs enfants terminent leur scolarité, c’est sans espoir d’occuper des emplois bien payés. Pour un même poste de travail, les salaires des femmes de plus de 40 ans sont inférieurs de 30 % en moyenne aux salaires de leurs homologues masculins. Enfin une proportion importante de femmes ne trouve d’emploi que dans le secteur tertiaire, moins bien payé, et surtout d’emplois à temps partiel : c’est le cas pour 40,6 % de la population active féminine de plus de 40 ans (cf. « Japan Quaterly », vol.XXIX, juillet 82).
L’OCDE écrit en 83 :
« La sensibilité conjoncturelle du taux d’activité des femmes semble plus élevée au Japon qu’ailleurs. D’après des estimations de l’OCDE, les sorties du marché du travail pendant les périodes de récession ont été plus marquées au Japon que dans la plupart des autres grands pays de l’OCDE. […] La faiblesse du marché du travail a été souvent compensée par la variation de l’offre de main d’œuvre, ce qui a permis au chômage de se maintenir à un niveau assez stable. Il est possible toutefois que l’augmentation du taux d’activité des femmes ait pour effet de modifier cette situation à l’avenir. Dès le début de 1983, le nombre des femmes dans la population active s’est accru malgré la dégradation du marché du travail.
Cette augmentation du taux d’activité des femmes remonte à 1975. […] L’emploi féminin a progressé au taux annuel de 1,7 % pendant la période 1975–1982. L’emploi des femmes à temps partiel s’est particulièrement développé, augmentant de 2,8 % par an. » (cf. « Problèmes et perspectives du marché du travail au Japon », in « Japon », OCDE, juillet 83).
L’augmentation du travail à temps partiel est générale dans l’industrie; entre 1975 et 1978 les travailleurs réguliers diminuent de 5,2 % alors que les travailleurs à temps partiel augmentent de 22,6 % (cf. Schwab, op.cit.); le tableau 2 montre la diminution du nombre de travailleurs réguliers dans l’industrie.
| Évolution comparée du nombre d’employés réguliers et de la production dans l’industrie (In « Economie Prospective Internationale », op. cit.). (1) Emplois réguliers 1982 : estimation. |
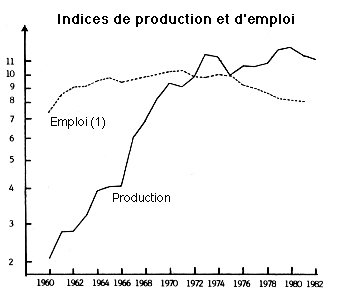 |
| Baisse du nombre d’employés entre 73 et 80 : Nippon Steel :-12,5 %; Nippon Kokan KK :-18,4 %; Sumitomo Metal Industries :-3,3 %; Kawasaki Steel Corporation :-22,1 %; Kobe Steel :-12,6 % (référence : « Diamond’s Japan Business Directory »).[25] |
Ce sont les entreprises les plus grosses qui ont le plus recours au temps partiel, puisque 75 % des entreprises de plus de 1000 employés, contre 53,7 % des entreprises de moins de 100 salariés emploient des travailleurs temporaires.
La période d’expansion économique, comme nous l’avons déjà indiqué avait vu se restreindre le fossé qui sépare les salaires dans les grandes entreprises et les salaires dans les petites entreprises. Depuis l’éclatement de la crise de 74–75 le fossé a recommencé à se creuser. Le salaire annuel moyen, toutes primes incluses, est inférieur d’un tiers dans les entreprises de moins de 30 salariés à ce qu’il est dans les entreprises de plus de 500 salariés; or, 56,3 % des salariés sont justement employés dans des entreprises de moins de 30 salariés. La différence des salaires est encore plus grande si on tient compte que la durée du travail dans ces petites entreprises y est supérieure d’une dizaine d’heures par mois. 60 % d’entre elles ignorent la semaine de 5 jours ( et une bonne partie des autres ne la pratique qu’irrégulièrement ) alors que 90 % des grandes entreprises l’ont instituée. Des horaires de travail de 60 heures par semaine n’y sont pas rares[26].
Pression accrue sur les salaires dans les petites entreprises, recours généralisé au travail à temps partiel dans les grandes, utilisation grandissante d’une main d’œuvre féminine moins payée, tels sont les traits saillants de la situation actuelle de la main d’œuvre japonaise, quelques années après l’éclatement de la crise économique, alors que le capitalisme nippon vole de record en record. Il faut ajouter aussi que la question des travailleurs immigrés risquera de se poser à l’avenir avec une acuité plus grande. Jusqu’à présent le nombre de travailleurs immigrés est au Japon beaucoup plus faible que dans les autres grands pays. Ces travailleurs sont principalement des Coréens, souvent « immigrés » depuis des décennies qui constituent une catégorie particulièrement exploitée et méprisée, mais numériquement restreinte, de la classe ouvrière du Japon. Mais récemment un courant d’immigration de travailleurs clandestins commence à apparaître et différentes déclarations patronales et gouvernementales indiquent que l’on commence à réfléchir sérieusement à cette solution pour obtenir du travail sous-paye.
Parallèlement à ce qui se passe dans les autres pays industriels, des coupes sombres commencent à être appliquées dans le système de sécurité sociale, pourtant plus faible qu’ailleurs; d’ores et déjà la « gratuité » des soins médicaux pour les personnes âgées a été supprimée et le pouvoir d’achat des pensions de retraite est en baisse.
Les attaques contre le système du « travail à vie » et de l’ancienneté se poursuivront inexorablement, en dépit du fait que la bourgeoisie est consciente du risque de « déstabiliser » une partie importante de la main d’œuvre. Sous les coups de la concurrence internationale, le capitalisme est contraint à développer et à accentuer son offensive anti-prolétarienne.
Nous avons vu quelques unes des conséquences les plus notables pour la classe ouvrière de la crise de 74–75. Au prix d’une détérioration de la situation des travailleurs, d’une aggravation de l’exploitation de la force de travail (qui se lit aussi dans l’augmentation des accidents du travail : 318 000 en 75, 334 000 en 78) le capitalisme du soleil levant réussit à surmonter la crise mieux que ses concurrents. La récession de 81–82 fut beaucoup moins sensible et en tout cas moins marquée qu’en Europe et aux USA, ce qui semble justifier la vantardise des bourgeois nippons, pour qui le Japon est un « mangeur » de crises . Cependant en dépit ou à cause de ces succès, le capitalisme japonais est conscient des menaces qui le guettent à l’approche d’une troisième récession mondiale depuis 74, à l’heure de « l’endaka », la hausse du yen.
En septembre 85, le dollar, alors à son niveau le plus élevé, a amorcé sa baisse, avec l’objectif d’améliorer la compétitivité des marchandises américaines, ou, comme on dit de « réduire le déficit commercial » (accords « du Plaza » entre les 5 grands de l’OCDE). Le dollar valait à ce moment 245 yens; il semble que les japonais aient accepté d’aller vers une parité de 200 yens pour 1 dollar. Mais cette parité n’a pas tardé à être enfoncée et on en est en août 88 à 145 yens (après avoir atteint 120 yens pour 1 dollar en décembre) : 170 % de hausse de la valeur du yen en 3 ans !
Cette modification du taux de change est l’arme principale dans la guerre commerciale entre le Japon et les USA. Elle s’accompagne cependant d’une série de mesures administratives, tarifaires et législatives prises tant par l’Amérique que par l’Europe pour freiner les exportations japonaises. Nous n’en sommes cependant pas encore à une guerre commerciale à outrance débouchant sur un retour au protectionnisme. Il s’agit surtout de faire pression sur le Japon pour qu’il se restreigne « volontairement », pour qu’il ouvre son marché aux marchandises étrangères, pour qu’il relance son économie intérieure afin de limiter la pression exportatrice et d’accélérer les importations de biens de consommation. Un représentant du Keidanren [Nippon Keizai Dantai Rengōkai], la fédération patronale japonaise expliquait :
« Pour sauvegarder le système du libre-échange (sic !), il convient de freiner volontairement les exportations à commencer par celles de véhicules »[27].
La reprise économique américaine, basée sur un recours massif à l’endettement, a entraîné à partir de 83 surtout un déficit croissant de la balance commerciale U.S. au profit des capitalismes concurrents, et en première ligne du Japon. En milliards de dollars, on a les chiffres suivants pour les balances commerciales de ces 2 pays :
| Année | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| U.S.A. | 11,3 | -3,2 | -40,0 | -98,5 | -105,2 | -129,6 | -150,7 |
| JAPON | 6,2 | 8,1 | 22,2 | 36,4 | 50,5 | 87,3 | 89,4 |
| (Source : FMI, « World economic outlook », avril 88) | |||||||
Ces chiffres éloquents, qu’on pourrait compléter par ceux parallèles de la balance des paiements, démontrent que le problème pour les américains reste entier; la reprise Reaganienne a durablement affaibli l’économie U.S. par rapport à ses concurrentes. De nouveaux épisodes de guerre commerciale sont donc à prévoir. Ils seront brutaux, car sous le règne du capital, les « ajustements » ne se font jamais en douceur et de façon harmonieuse, mais selon la règle du « chacun pour soi » et la loi du plus fort. Les U.S.A. utiliseront à plein leur supériorité encore indiscutable pour faire payer aux autres les prix de leur convalescence. Le seul frein dans cette voie, est le risque que le Japon, devenu depuis 85 le pays qui exporte le plus de capitaux, le « premier financier » du monde (alors que les U.S.A. sont devenus le premier emprunteur), retire ses capitaux, en grande partie utilisés pour souscrire aux emprunts américains, c’est-à-dire en définitive pour soutenir la croissance américaine. Il tient donc entre ses mains cette croissance. Mais c’est là une arme à double tranchant, qui ne pourrait être utilisée consciemment qu’en acceptant de se faire « hara-kiri », de se ruiner. Or le code d’honneur des samouraïs ne dicte pas plus les calculs économiques des capitalistes japonais que les règles de la chevalerie le font pour les opérations boursières des financiers de Wall Street… .
Le capitalisme japonais « mangeur de crises » digère pour l’instant la hausse du yen et la guerre commerciale, mais ce n’est pas sans mal. L’année 86 a été difficile : les exportations ont chuté, la production industrielle a baissé de même que les profits, la croissance du PNB a été la plus faible depuis 1974. En 1987 pourtant la croissance a repris et se poursuit cette année. Les raisons en sont multiples; d’abord le Japon utilise peu sa propre monnaie pour les échanges commerciaux[28], ce qui est une façon de se prémunir contre les variations des taux de change. Ensuite beaucoup de grandes industries s’implantent à l’étranger, USA ou Europe, pour contourner les barrières commerciales, soit dans les pays sous-développés pour bénéficier des bas salaires. C’est le « hollowing up » ( littéralement le « ravinement ») de l’économie, dénoncé tant par les réactionnaires que par les réformistes japonais. Enfin il y a les tant vantées robotisations des usines japonaises[29]. Le « livre blanc » du MITI (Ministre du Commerce et de l’Industrie) de 86 mettait en avant 4 facteurs pour surmonter les crises :
1. Le prix des exportations en dollars;
2. La réduction des coûts des fournisseurs locaux;
3. Le renforcement de la compétitivité sur les plans autres que les prix;
4. La réduction des coûts de production.
Pour les bourgeois, « réduction des coûts de production » signifie avant tout, baisse des charges salariales, augmentation de l’exploitation. Et c’est en fait surtout le prolétariat japonais qui a fait les frais de la digestion de la crise.
• Au niveau des salaires; nous ne disposons pas de statistiques récentes et fiables des salaires. Les chiffres courants indiquent que les salaires des travailleurs japonais sont devenus, comparativement, les plus élevés du monde. Mais cette « hausse » relative traduit en fait la hausse du yen; elle ne doit pas cacher la durée globale du temps de travail, supérieure nettement aux durées américaine et européenne, et dont une partie n’est pas payée[30], ainsi que le fait que ces chiffres portent toujours sur les salaires des grandes entreprises, excluant ceux des petites entreprises, des travailleurs temporaires, etc.
Un autre indice peut nous laisser entrevoir la réalité, celui du « pouvoir d’achat des ménages ».
« Entre 1965 et 1973, le taux de croissance réel annuel du revenu disponible était de 5,8 % en moyenne. Mais entre 1973 et 1986 ce taux de croissance réel annuel a nettement diminué pour n’atteindre qu’une moyenne de 0,9 % ». Et en fait « le pouvoir d’achat a effectivement baissé deux années de suite »[31] ces derniers temps. Si on garde à l’esprit qu il s’agit de chiffres moyens, qui incluent toutes les classes, on peut en conclure que les prolétaires japonais ont réellement du connaître des baisses du pouvoir d’achat de leurs salaires, et pendant plus de 2 années.
• Au niveau du chômage; les secteurs qui ont le plus licencié sont ceux qui ont été le plus durement touché par la guerre des taux de change : mines de charbon, sidérurgie, industries des métaux, du traitement de diverses matières premières, construction navale. La tonne de charbon importée revient à 8620 yens, alors que la tonne extraite localement coûte 24 200 yens (chiffres de 1987) ! La production locale est passée de 50 millions de tonnes en 1960, avec 230 000 employés, à 16 millions de tonnes et 14 000 employés en 1986. Remarquons au passage le bond énorme de productivité en 26 ans : 510 % (217 tonnes extraites par employé en 1960, contre 1142 en 1986), qui a eu sa traduction concrète en épuisement et morts de mineurs. En 1981 une explosion avait fait 100 morts dans une mine de Yūbari (Hokkaido), une des principales régions minières du pays. Ces dernières années, d’importants investissements avaient fait des puits de Yūbari les plus modernes et les plus performants de l’archipel. Et pourtant, en dépit de la prolifération de l’électronique (notamment pour la sécurité) dans la mine, un nouveau coup de grisou en mai 85 y faisait 62 morts et une vingtaine de blessés. La presse japonaise a dénoncé le mauvais état des systèmes de sécurité…. Investissements, productivité, en régime capitaliste ne riment pas avec sécurité, mais avec insécurité. En 5 ans il y a eu dans les mines japonaises 266 morts et 66 blessés. Mais pour les habitants de ces régions, où les chômeurs sont « aussi nombreux qu’en Europe », être mineur est une chance[32].
Dans la sidérurgie, on prévoyait en 86 le licenciement de 40 000 travailleurs ( sur 180 000 ); la détérioration de la situation fait que le MITI parle maintenant de supprimer 90 000 emplois d’ici 1990.
Dans la construction navale, 2 programmes de « rationalisation » ont déjà été rendus publics, prévoyant une diminution de plus 20 000 emplois.
Ce sont là des secteurs dits « traditionnels » qui avaient déjà licencié après la crise de 74–75 et qui sont en difficulté dans la plupart des grands pays industriels. Mais la réduction de l’emploi touche aussi des secteurs et des entreprises de pointe, qui symbolisent le Japon performant. SONY, prévoit officiellement une réduction de 20 % de son personnel japonais (et sans doute davantage en réalité) à la suite de ses implantations à l’étranger. Même l’automobile a réduit ses objectifs, même si là comme ailleurs ce sont les sous-traitants qui ont le plus souffert. TOYOTA a licencié, NISSAN a réduit les horaires de travail (en 88, la demande ayant repris, NISSAN supprimera les congés, dans les 2 cas avec l’accord du syndicat !).
En tout on estime que de 1986 à 1987 400 000 emplois ont été supprimés dans l’industrie. Le taux de chômage officiel a atteint le niveau record de 3,2 % (rappelons qu il faut le multiplier par 2 à 3 pour donner une image plus exacte de la réalité. Cf. note 24).
Un autre moment important de cette offensive contre l’emploi porte sur les salariés de la fonction publique.
Le programme des privatisations en cours comporte ouvertement un volet anti-ouvrier, particulièrement marqué dans le cas des Japan National Railways (chemins de fer japonais ). La J.N.R. estimait à 93 000 sur 276 000 le nombre de travailleurs « en surnombre »; la privatisation doit aboutir rapidement à supprimer 50 000 emplois : 20 000 départs à la retraite « volontaires ». 30 000 travailleurs recasés dans diverses sociétés, « fast-food » et autres petits-boulots, les travailleurs en surnombre restant, étant encore pour un temps à la charge de la J.N.R.
La privatisation de la J.N.R. a été en fait marquée par les seules réactions d’ampleur des travailleurs contre l’offensive capitaliste, avec y compris des actes de sabotage. Le syndicat Sōhyō, « de gauche », soi-disant « combatif », soi-disant « cible » du gouvernement, a en pratique vendu le mouvement de grèves contre des clopinettes, après avoir entraîné les travailleurs dans l’ornière corporatiste de la défense de l’entreprise et du « service public ».
• Le troisième volet de l’offensive anti-ouvrière est l’intensification de l’exploitation.
Les noms de certaines des méthodes du capitalisme japonais sont hélas connues maintenant par les prolétaires occidentaux : « cercles de qualité », « zéro défaut », « salaire au mérite ». Elles visent à renforcer le lien entre le travailleur et l’entreprise, en le faisant « participer » à sa propre exploitation, en lui donnant l’illusion que l’entreprise est une collectivité dont il doit défendre les intérêts avant même les siens propres.
Les « cercles de qualité » (c.q.), comme le « zéro défaut » sont en fait d’origine américaine[33], mais c’est le capitalisme japonais qui les a généralisé. Dès 1976 plus de 71 % des entreprises avaient des c.q. Un des promoteurs des c.q. les décrivaient ainsi :
« La solution est de créer un système qui lie les travailleurs par le cœur et l’âme, en tant qu’être humains, et les aide à manifester pleinement leurs capacités et leurs créativités respectives ».
Dans cet effort pour arriver à un contrôle totalitaire sur les prolétaires, certaines entreprises, à la suite de la sidérurgie, ont même baptise « campagnes d’autogestion » le mouvement d’implantation des c.q. Ce qui faisait dire à un bonze « de gauche » :
« aujourd’hui les jeunes travailleurs savent parler en public parce qu’ils ont assisté à de nombreuses séances de c.q. et fait des rapports sur leurs activités. Avant, les travailleurs devenaient de bons orateurs par l’activité syndicale. Les c.q. ont usurpé le rôle de la militance ouvrière dans le syndicat »[34].
Voilà qui en dit long sur le rôle de. . . cette militance et de ces bonzes !
Avec les c.q., les campagnes « zéro défaut », un troisième aspect s’est généralisé pour intensifier l’exploitation, qu’on retrouve maintenant aussi en Europe le « salaire au mérite » . Le cas extrême est sans doute celui de NISSAN, entreprise dont nous avons déjà parlé. Le « salaire régulier », hors donc heures supplémentaires, primes de rendement, etc., se décompose ainsi : « salaire de base » 13,5 %, allocation de qualification 2,4 %, allocation familiale 4,5 %, allocation « spéciale » 72,9 % (chiffres de 1978). Cette allocation spéciale est attribuée au mérite. On voit donc la fraction extraordinairement importante du salaire qui est « au mérite », donc dépendante du bon vouloir de la direction et de l’encadrement, gage de la docilité du travailleur.
La vigoureuse offensive bourgeoise a été couronnée de succès. Les « coûts salariaux » ( voir tableau 3) après avoir cru parallèlement à la montée du yen, sont redescendus à des niveaux comparables ou inférieurs à ceux des autres grands pays capitalistes.
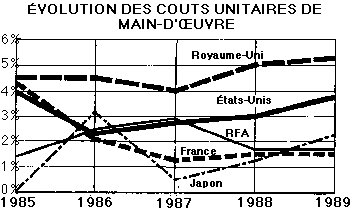 |
| (Source : « Le Monde », 6 juillet 1988). |
Les bénéfices en baisse de 8,3 % en 86–87 devraient augmenter de 19 % en 88[35]. En dépit de la baisse en volume des exportations, l’excédent commercial a battu en 1987 tous les records. La production industrielle, le PNB, ont augmenté à la suite du vigoureux plan de relance économique élaboré en 86, principalement axé sur les grands travaux. Une orgie de spéculation sur les terrains à bâtir accompagne l’orgie de spéculation à la bourse de Tokyo, le fameux Kabuto Cho dont les niveaux donnent le vertige aux financiers occidentaux échaudés par le Krach d’octobre, mais sont l’orgueil des japonais : Kabuto Cho n’a t-il pas dépassé, en valeur, Wall Street ?
Mais par ailleurs les menaces d’aggravation de la guerre commerciale se font toujours plus précises, amenant à poser la question : où va le Japon ?
La réponse officielle a été donnée en 86 par un rapport au Premier Ministre, le « rapport Mayekawa ». Pour le « grand spécialiste » bourgeois du Japon, Ch. Sautter, ce rapport « crucial » décrit le très souhaitable « scénario de l’harmonie pacifique »[36] qui répondrait de façon positive, aux critiques des capitalismes occidentaux. Les points importants sont l’ouverture du marché nippon, la croissance par le marché interne et pas par les exportations, la coopération internationale. Au plan social, on y trouve la réduction du temps de travail, des hausses de salaires, une amélioration du cadre de vie, etc., etc.
Ce rapport a fait le tour du monde, mais a rencontré en général le scepticisme. A titre d’exemple, voici comment un économiste japonais conclut une analyse de ce rapport :
« devant tant d’incertitudes, l’ensemble des suggestions contenues dans le rapport semblent surtout destinées à apaiser temporairement le courroux du partenaire américain, plutôt qu’à servir une réforme assurément suicidaire »[37].
En réalité au Japon comme ailleurs le capitalisme n’est plus dans un période de croissance apparemment illimitée et harmonieuse, suffisante pour promettre l’abondance et assurer une croissance lente, mais indéniable du niveau de vie. Nous ne sommes plus dans la période du « progrès social » et de « l’État-providence ». C’est l’heure de l’ukeika, le « virage à droite », aile sociale et politique de l’offensive bourgeoise anti-ouvrière. Dans une interview à un journal américain, Inayama, président du Keidanren, ancien président de la Nippon Steel, réduit en cendres les phrases du rapport Mayekawa par ces deux formules :
« si nous ne pouvons pas être compétitifs vis-à-vis de la Corée à cause de hauts salaires, et bien nous réduirons les salaires » et « nos horaires de travail ne vous regardent pas ».
Cette offensive bourgeoise a une importante traduction sur le plan de l’organisation syndicale, avec l’objectif d’une centrale unique. Le mouvement pour l’unification a été lancé en 1981, sur la base des positions de la « Fédération Internationale des Métallurgistes – comité Japon » (IMF-JC). L’IMF-JC insiste sur le soutien aux plans anti-ouvriers de « rationalisation » et défend clairement les intérêts des secteurs industriels de l’exportation. Un des syndicats importants adhérant à l’IMF-JC est le syndicat de NISSAN, né comme briseur de grèves, qui n’appartient à aucune des grandes Confédérations. D’autres syndicats de IMF-JC sont affiliés à Sōhyō ou à la Dōmei. Mais c’est la Dōmei qui doit constituer l’axe de la nouvelle centrale. En effet un des points explicites de la fusion est la rupture des liens de Sōhyō avec le parti socialiste, l’exclusion de tout syndicat gardant des liens avec celui-ci ou avec le PC, ou étant sur des positions « de gauche ». Parmi les autres points on trouve : fin de l’opposition aux mesures de « rationalisation » et de « transformation structurelle de l’industrie » (implantations à l’étranger); rénovation des JNR et des autres entreprises d’État par la « réforme administrative » (privatisations et licenciements).
Ce projet de fusion a été combattu par les bonzes proches du PS qui y dénoncent une « attaque contre l’esprit militant de Sōhyō » (!) alors que les plus importants secteurs de Sōhyō en sont promoteurs, par les syndicats liés au PC qui ont annoncé qu’ils créeraient leur fédération nationale après l’unification.
La première étape de l’unification concerne le secteur privé; elle a eu lieu en novembre 87 par la création de la nouvelle centrale Rengō [Nihon Rōdōkumiai Sōrengō-kai], regroupant la Dōmei, la Fédération des syndicats indépendants (Churitsu Rōren), les syndicats du privé de Sōhyō et les syndicats autonomes, soit en tout 5,5 millions d’adhérents. La deuxième étape, la fusion avec le gros de Sōhyō, c’est-à-dire les syndicats du secteur public (4 millions d’adhérents) doit avoir lieu en 89, une fois que le « ménage » aura été fait dans ses rangs.
Le président de l’organisation patronale chargée des « problèmes du travail » fait ce commentaire satisfait sur Rengō :
« c’est une organisation précieuse, car elle ne se situe pas sur le terrain idéologique, mais tient compte de la situation économique ».
Déclaration vérifiée par les résultats de « l’offensive de printemps » de 1988, organisée par Rengō, où « le patronat a mené la jeu de bout en bout ». Selon Rengō les revendications de salaire doivent passer au second plan… .
• • • • •
On ne peut manquer de faire une comparaison entre l’évolution actuelle et la période d’avant-guerre. Comme dans les années 30, la bourgeoisie réorganise l’encadrement syndical dans le sens d’une diminution toujours plus grande de l’autonomie des organisations syndicales afin de mobiliser la force de travail pour la guerre – commerciale, cette fois-ci. Même la Sōhyō et les bonzes social-démocrates lui paraissent non pas « combatifs » – ils ne se sont jamais opposés aux intérêts bourgeois – mais trop faibles par rapport aux revendications ouvrières, trop enclins à jouer la comédie de la lutte. Trahir une lutte, c’est bien, mais faire en sorte que la lutte n’éclate pas et mobiliser la travailleurs pour la production, c’est bien mieux. Le capitalisme japonais moderne, démocratique et civilisé, reprend les méthodes des camarillas fascistes du Japon impérial d’avant-guerre, « arriéré » et « semi-féodal ». Mais grâce à la démocratie, il les reprend en douceur, sans avoir à briser par la répression un mouvement ouvrier faible et jeune, mais néanmoins combatif, comme celui des années 20.
Le gigantesque prolétariat japonais d’aujourd’hui a entre ses mains une force potentielle immense, capable de briser tous les plans et toutes les tentatives bourgeoises de le maintenir éternellement soumis. Il pourra utiliser cette force et la faire jouer en faveur de la révolution mondiale, en retrouvant dans le passé de la classe ouvrière, non pas japonaise, mais internationale, les méthodes, les moyens et les buts anti-démocratiques et anti-capitalistes de la lutte de classe. C’est là un processus qui ne sera ni simple, ni rapide. Il nécessite la maturation des conditions objectives de crise économique ruinant les avantages matériels acquis depuis la fin de la guerre.
Mais en silence, dans le sous-sol économique et social du capitalisme mondial, la vieille taupe creuse, préparant le grand tremblement de terre prolétarien annonciateur de la submersion du capitalisme japonais, dans un scénario plus crédible que ceux des films-catastrophe produits à la chaîne par les studios de Tokyo, ou que celui, encore plus fantastique de l’impossible « harmonie pacifique » bourgeoise.
Notes :
[prev.] [content] [end]
Cf. Saburo Ienaga, « La situation des études japonaises sur la résistance au Japon durant la 2ème guerre mondiale », « Rivista Storica Italiana », juin 1977. [⤒]
Cf. Sung-beh Chung, « Les relations du Japon et des États-unis depuis 1945 », « Notes et Etudes documentaires », № 25, juin 75. Sur la « démocratisation » au Japon, cf. aussi « Prometeo » № 3, oct. 1946, où on prévoyait notamment :
« le Japon ne peut plus désormais vivre que comme province des USA. C’est sa condamnation en même temps que son unique possibilité de renaissance; renaissance s entend en vue de la guerre. » [⤒]Iwao F. Ayusawa, « A history of labor in modern Japan », Honolulu, 1966. [⤒]
Sung-beh Chung, « Les relations du Japon et des États-unis depuis 1945 », « Notes et Etudes documentaires » № 25, juin 75, p.12. [⤒]
J. Halliday, « A political history of japanese capitalism », New-York 1975, pp.217-8. [⤒]
Cf. Sung-beh Chung, « Les relations du Japon et des États-unis depuis 1945 », « Notes et Etudes documentaires » № 25, juin 75., et P. Fistié, « La rentrée en scène du Japon », 1969. [⤒]
Le traité de paix avec les alliés occidentaux (l’URSS ayant refusé) et le traité de sécurité (en fait une alliance militaire déguisée avec les USA) datent de 1951. [⤒]
Le PC n’adopta une ligne anti-américaine qu’après que le SCAP et les libéraux se soient lancés dans de vastes épurations de ses cadres dans les usines (et donc dans les syndicats); auparavant le PC considérait l’armée US comme une « armée de libération » et il s’était bien gardé de s’opposer au SCAP. [⤒]
organisation née en opposition à la guerre du Vietnam au milieu des années 60 qui, quoique en n’ayant pas une composition strictement prolétarienne, avait une certaine influence sur les ouvriers les plus combatifs et avait reçu une forte impulsion du rejet par des couches, ouvrières ou non, de la bureaucratie syndicale. Le Hansen Seinen Inkai (« Comités de jeunes contre la guerre ») est à l’origine de nombreuses grèves « sauvages » dans l’industrie ou dans les services publics et de nombreuses manifestations d’opposition à l’impérialisme japonais. Ce n’était pas une organisation bien définie, mais un mouvement qui soutenait ou impulsait des formes d’organisation spontanées des ouvriers : comités de défense, de lutte, etc. Cf. S. Belleni, « Zengakuren zenkyoto », Milan 1969. et J. Halliday et MacCormack, « Imperialismo giapponese », Turin 1975. [⤒]
Koji Taira, « Economic development and the labor market in Japan », New-York 1970. [⤒]
elles naquirent en 1955 à l’initiative d’un groupe de dirigeants de la Sōhyō qui pensaient organiser une action conjointe au lieu de créer une fédération avec des liens étroits entre les différents syndicats d’entreprise. Elles font partie depuis cette date de la tradition syndicale et elles se répètent chaque année. Les dirigeants syndicaux choisissent une catégorie « forte » pour commencer la « lutte ». Les revendications et les résultats obtenus servent ensuite de modèle aux catégories qui se mettent successivement en mouvement. Le but pour les syndicats est de suppléer à la faiblesse du système d’entreprise et de participer à la politique d’élaboration de la politique nationale du travail. [⤒]
« Le syndicalisme japonais est dans un stade de transition. Les syndicats d’entreprise sont encore la forme dominante d’organisation; mais en même temps le shunto (offensive de printemps) fournit une solide base de coalition multi-syndicale qui peut être mobilisée chaque année, même s’il ne s’agit pas d’une institution permanente comme le syndicat confédéral dans les pays occidentaux. Sous certains aspects le shunto est plus fort que beaucoup de confédérations syndicales. »
Cf. J. Halliday, « A political history of japanese capitalism », New-York 1975. [⤒]pour une analyse plus détaillée, il faut considérer que les travailleurs syndiqués sont en nombre moins grand que dans la plupart des pays industrialisés. Les travailleurs syndiqués sont plus nombreux dans les grandes entreprises que dans les petites. Cf. L. Schwab, « Le Japon, réussites et incertitudes économiques », Paris 1984. [⤒]
Une confirmation indirecte du caractère ultra-collaborateur de la Sōhyō est donnée par les formes de lutte adoptées et le nombre de grèves. Si de temps à autres elle recourt à la grève générale, elle apparaît néanmoins comme nettement moins « combative » que les syndicats occidentaux, américains y compris. Les « offensives de printemps » se déroulent dans beaucoup de secteurs sans la moindre grève (mais les syndiqués se mettent un brassard rouge au bras !) et la longueur moyenne des grèves tourne entre 2 ou 3 jours. [⤒]
Cf. « Le Japon aujourd’hui », Ministère des Affaires étrangères, 1976, pp. 55–72. [⤒]
Ces dernières années le PC japonais a suivi une évolution de type « eurocommuniste » accentuant son indépendance par rapport à Moscou. [⤒]
Cf. « Recession, revolution and metropolis-periphery in East Asia, with special reference to Japan » in « Journal of Contemporary Asia », № 3, 1977. [⤒]
en particulier parce qu’après 1945 le Japon n’a guère fait appel à une main d’œuvre immigrée sous-payée et que le capital a pu facilement transférer une partie de son industrie dans d’autres pays asiatiques
« la classe ouvrière japonaise a subi des coups relativement plus durs que ses homologues européens où beaucoup de l’impact a été supporté par les travailleurs étrangers qui ont été expulsés »
J. Halliday, « A political history of japanese capitalism », New-York 1975.[⤒]Ch. Sautter, « Japon, le prix de la croissance », Paris 1973, p.359. [⤒]
« A l’intérieur des entreprises NISSAN existe une structure hiérarchique élaborée qui lie la direction au personnel de contrôle de la main d’œuvre. Les 3 catégories du personnel de contrôle du niveau supérieur doivent être constituées de diplômés ou de travailleurs ayant au moins 15 ans d’ancienneté, ou un passage dans l’enseignement supérieur plus 4 ans d’ancienneté. Les ouvriers sont divisés en 4 catégories : dans l’ordre, de haut en bas, les ouvriers « réguliers », les ouvriers engagés à l’essai, les ouvriers temporaires, les ouvriers saisonniers […]. NISSAN maintient ces ouvriers rigoureusement séparés, les fait surveiller par du personnel régulier, les loge dans des baraques assez semblables à des casernes qui laissent à chacun un espace de 2 mètres carrés environ. Tout au long de l’année il y a une couche de travailleurs dont le statut est nettement inférieur à celui des travailleurs réguliers. […] Pour rester plus de 3 ans chez NISSAN il faut devenir soit un membre du personnel de contrôle, quel qu’en soit le niveau, soit un fonctionnaire syndical »,
J. Halliday et MacCormack, op. cit., p.215. Pour une description des conditions de vie et de travail dans une autre grande entreprise de l’automobile, cf. « Toyota, l’usine du désespoir », Ed. Ouvrières.
Dans l’industrie un grand nombre de ces parias sont des femmes vis-à-vis desquelles les discriminations sont plus grandes que dans les autres pays industriels. En 1972, elles constituaient 57,5 % des ouvriers (46,5 % de la population active) : on comprend l’importance que revêt l’exploitation des femmes dans l’accumulation au Japon. Cf. J. Halliday, op. cit. pp 224–25 et Kaji Etsuko, « The invisible proletariat : working women in Japan » in « Ampo », automne 1973.
Rien d’étonnant si le prolétariat féminin est plus combatif et plus enclin à la solidarité de classe et s ils s’est fait promoteur de diverses luttes en dehors des syndicats officiels, en particulier contre les discriminations sexistes. [⤒]Ch. Sautter, « Japon, le prix de la croissance », Paris 1973, p.153. [⤒]
Ch. Sautter, « Japon, le prix de la croissance », Paris 1973, p. 120. Schwab, op. cit. donne les indications suivantes : pour une base 100 dans les entreprises de plus de 500 salariés, on avait un salaire de 70,7 dans les entreprises de 100 à 500 salariés, un salaire de 58,9 pour les entreprises de 30 à 100 et un salaire de 46,3 pour les entreprises plus petites en 1960. Les écarts se resserrent ensuite et en 1975 on a les chiffres respectifs suivants : 100, 85,7; 75,8 et 70,3. En 1979, les écarts ont recommencé à augmenter : 100, 82,7 , 71,3 et 68,1. [⤒]
Il y a quelques années a eu lieu une augmentation des dépenses étatiques pour les retraites et les dépenses de santé, dans le but de soulager les charges fiscales des entreprises et pour stimuler la consommation intérieure, très déprimée par l’inflation des années 70. Cependant cette augmentation n’a pas modifié la situation , comme en témoignent les tendances au recul de l’âge de la retraite. [⤒]
Le chômage n’est pas inconnu au Japon, surtout après 1971. Mais les indices officiels indiquent des chiffres toujours extraordinairement bas. Les rédacteurs de la revue bourgeoise « Economie Prospective Internationale » écrivent :
« La définition japonaise du chômeur conduit à une sous-estimation du chômage. En effet la comptabilisation du chômage par données d’enquête ne tient compte que des personnes n ayant aucune activité rémunérée pendant la semaine de l’enquête et à la recherche d’un emploi par les canaux officiels. Ainsi sont exclus a priori de l’échantillon statistique (échantillon de 76 000 personnes pour une population active de 89 millions) les employés temporaires, les journaliers et les travailleurs familiaux non rémunérés. Les experts estiment ainsi qu’il faut doubler le taux de chômage « officiel » pour obtenir un taux homogène avec celui des autres pays industrialisés ».
« E.P.I. », № 15, 3ème trimestre 1983.
De son côté, la « Note de l’IRES » écrit :
« Officiellement le taux de chômage au Japon est très faible : 2,7 % de la population active en 1984. Mais ne sont pas comptabilisés comme chômeurs […] beaucoup de monde. Un calcul tentant d’harmoniser les statistiques japonaises et les statistiques européennes du chômage ferait vraisemblablement tripler le taux officiel »
cf. « Ombres et lumières du modèle japonais » in « Note de l’IRES », № 4, juin 85.
Ces différentes estimations aboutiraient à un taux de chômage pour 87 proche de 9 %, supérieur au taux américain : voilà un des éléments du « miracle » japonais qui s’évanouit… . [⤒]une grande partie des sources statistiques d’origine officielle sur l’économie japonaise de 70 à 76 se trouve dans : Manfred Pohl, « Japan 1976–77, Politik und Wirtschaft », Hamburg 1977. Pour les années suivantes, se reporter aux différents No. de « Perspectives de l’OCDE », « Economie Prospective Internationale », № 13 et 15. [⤒]
« De nombreux analystes économiques décrivent, non sans admiration, des réalités économiques nippones et vont même jusqu’à parler de « modèle japonais ». Ils citent à l’appui de leur démonstration les chiffres officiels qui attestent un faible taux de chômage, une inflation mesurée, des excédents commerciaux considérables , une croissance soutenue. Leur diagnostic s appuie en fait sur une présentation statistique des réalités économiques qui est singulièrement optimiste. Non que les statistiques soient délibérément faussées ou trafiquées, acte inconcevable au Japon comme dans tout autre pays démocratique (sic ! – NDLR), mais elles sont souvent établies sur des bases fort différentes de celles utilisées ailleurs, en particulier aux États Unis ou en Europe. […] Tout se passe comme si, malgré une croissance économique relativement forte, la population japonaise ne recevait que les miettes de celle-ci. »
Cf. « Note de l’ IRES », op. cit. L’article critique en détail différentes statistiques officielles, comme celles du salaire moyen, de l’inflation, etc. Les femmes constituent une part importante des travailleurs temporaires ou à temps partiel; mais elles travaillent souvent en fait jusqu’à 48 heures par semaine dans les services, pour un salaire de 2,4 dollars de l’heure. Une étude du Ministère du travail de fin 82 recensait 1,2 million de femmes travaillant à domicile pour un salaire moyen de 302 yens (moins de 10 FF). En général le salaire des femmes reste toujours inférieur à celui des hommes et cet écart a même tendance a s’accroître. Le salaire féminin ne représente plus en moyenne que 52 % de celui des hommes, contre 56 % en 1978. Cf. « Business Week International », 4/3/85. [⤒]Cf. « La Tribune de l’Expansion », 1/2/86. On a eu des accords « d’auto-limitation » vis-à-vis des USA des exportations d’acier en 69 et 72; des textiles en 71 (contre la restitution au Japon d’Okinawa); des téléviseurs en 77, des automobiles à partir de 81, etc. cf. « Le Monde Diplomatique », nov. 86. [⤒]
Seules 36 % des exportations japonaises sont facturées en monnaie nationale et 7,3 % des importations (chiffres de 85), alors que les proportions respectives sont de 98 % et 85 % pour les USA, 82 % et 43 % pour la RFA, 62 % et 36 % pour la France. Cf. « Le Monde Diplomatique », fév. 88. [⤒]
Cf. « The Hollowing, a new threat to Japan’s super economy » in « Ampo », № 1/1987. La robotisation dont on nous rebat les oreilles n’est pas un mythe. Si elle signifie réduction du nombre des travailleurs, elle ne signifie pas disparition de ceux- ci. FANUC, une des premières entreprises mondiales de machines-outils, a construit une « usine sans ouvriers » qui fait la stupeur des gogos. Mais cette usine est alimentée par le travail à domicile, sous-payé, de milliers d’ouvrières, notamment coréennes. Le modernisme technologique se marie aux formes les plus « vieilles » et les plus brutales de l’exploitation. [⤒]
Cf. « Consommation de masse : la fin d’une ère » in « Japon Economie », 30/7/87. Si, selon certains sondages près de 90 % des japonais disent faire partie de la « classe moyenne », les dernières années ont vu l’apparition des « nyu pua », les « nouveaux pauvres », constitués de salariés dont le niveau de vie a fortement baissé, cf. « Business Week International », 29/8/88. [⤒]
Cf. « Consommation de masse : la fin d’une ère » in « Japon Economie », 30/7/87. [⤒]
Cf. « Libération », 20/5/85. [⤒]
nous reprenons les données qui suivent de Muto Ichiyo, « Lutte de classe et innovation technologique au Japon depuis 1945 » in « Cahiers d’Etude et de Recherche », № 5, 1987. [⤒]
Cf. « Le Monde », 18/12/87. [⤒]
Cf. « Le Monde », 18/12/87. [⤒]
Cf. Ch. Sautter, « Les dents du géant » , Paris, 1987. Le rapport est décrit pp 240–250 . [⤒]
Cf. Hiroko Yamane, « Les japonais ne peuvent si facilement céder aux pressions de Washington » in « Le Monde Diplomatique », nov.86. [⤒]
